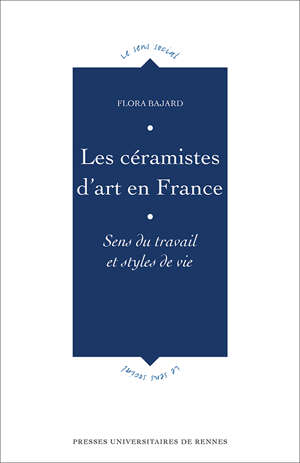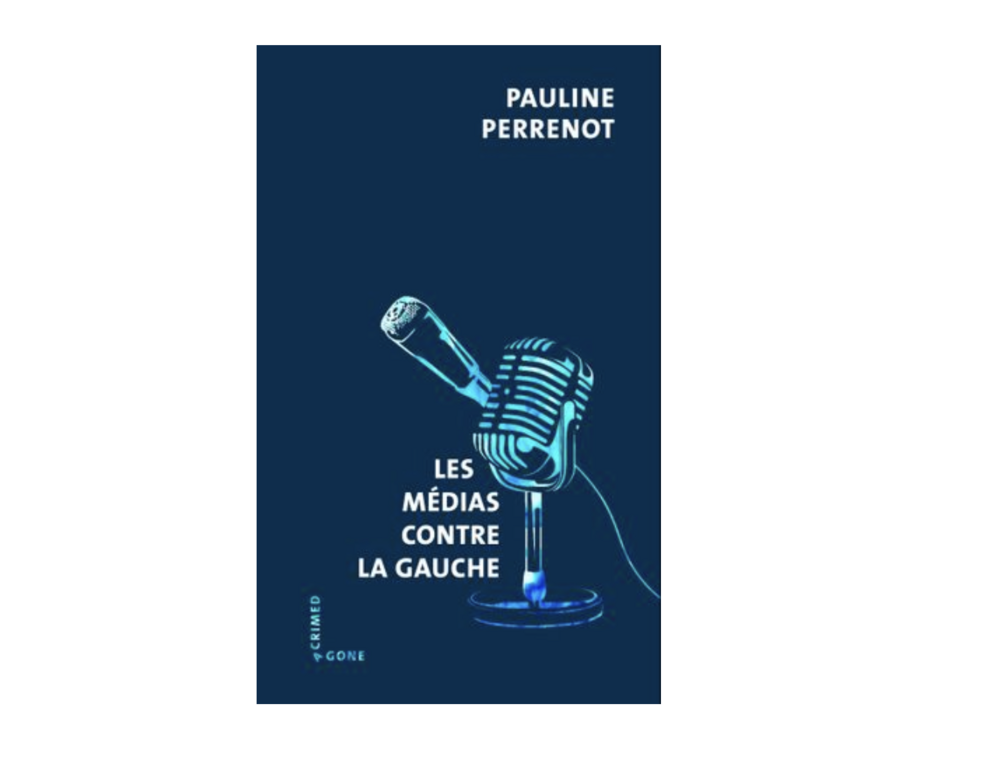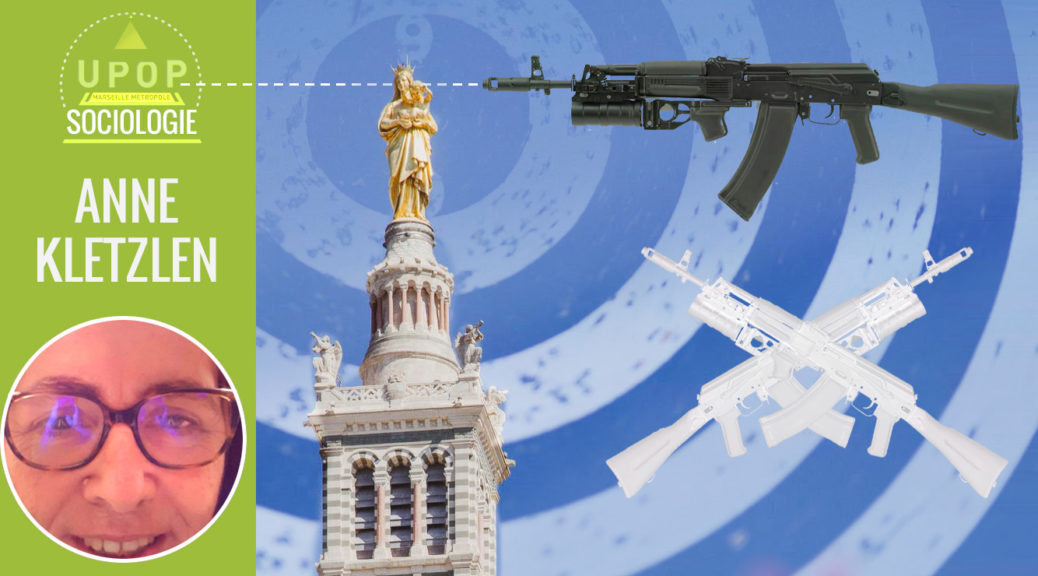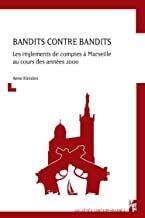Le travail entendu comme une dépense d’énergie en vue de réaliser un produit ou un service, est une activité quotidienne partagée par tous les humains. Elle prend plusieurs formes (salarié, indépendant,
domestique, associatif) et inscrit les personnes dans des rapports de travail, tant hiérarchiques que coopératifs. Le travail est aussi marqué par son ambivalence, tout à la fois source de souffrance et de
créativité, d’exploitation et de possible émancipation. Chacun a un rapport singulier au travail qui, selon les circonstances, prend ou non du sens et assure ou non une reconnaissance.
L’utopie est une critique de l’existant. Elle est une espérance et une nécessité. Elle est une projection vers un ailleurs, un autrement, un meilleur. Elle est un projet destiné à dépasser ce que les situations ont d’insupportable. Elle est une énergie, un désir de dépassement, une
dynamique collective. Elle exprime un rapport spécifique au temps, à l’espace et à l’extérieur. Souvent théorique, elle peut aussi se matérialiser dans des utopies concrètes qui expérimentent de nouvelles manières de faire et de vivre ensemble.
Les utopies du travail sont ainsi de nouvelles façons de concevoir le travail, de l’organiser, de l’orienter, de lui donner du sens. Elles mettent en place des innovations techniques et sociales et testent de nouvelles façons de faire et d’être qui rendent possibles d’autres manières de produire ensemble. Ceci n’exclut pas pour autant, les dimensions ambivalentes du travail ni les difficultés inhérentes à toute forme d’action collective. Dans les utopies, le travail est vertueux, choisi, varié, autonome, source de satisfaction et d’épanouissement.
Ces questions seront développées par Enrico Donaggio et José Rose, membres de l’Atelier de recherche Travail et Libertés (IMERA-AMU).
José Rose est professeur émérite de sociologie à Aix Marseille Université, ancien directeur scientifique du Céreq et membre du LEST-CNRS (Aix Marseille Université). Il travaille notamment sur les transformations du travail et de l’emploi, les relations entre formation et emploi, école et entreprises, l’insertion professionnelle des jeunes et les transitions professionnelles ou encore l’évolution de l’enseignement supérieur.
Enrico Donaggio est Maître de Conférence en Philosophie à l’Université de Turin, professeur de philosophie et pratique de l’interdisciplinarité à Aix-Marseille Université, directeur scientifique de l’Institut d’études avancées (IMéRA), où il coordonne l’Atelier de recherche travail et libertés (ArTLib). Il a coordonné : Travail e(s)t liberté ?, publié par les Éditions Eres, Toulouse.