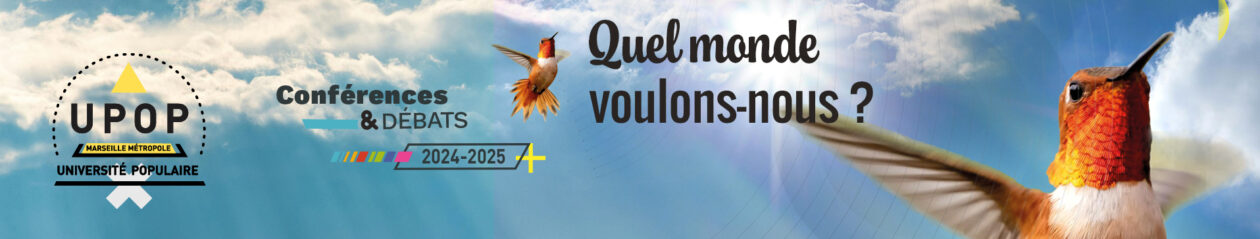Quel monde voulons-nous ?
« Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde y parviennent »
Henry Dunant
S’agit-il de cette folie illustrée par l’arcane du Mat, le Fou du Tarot de Marseille, impétueux et irrationnel, souvent lucide et courageux, marchant d’un pas décidé vers l’inconnu, vers son avenir, vers l’inéluctable, vers un monde nécessaire, inévitable, inexorable ?
Face à l’accroissement révoltant des inégalités avec leur cortège de misère et de souffrance, la multiplication des conflits armés de haute intensité, la résurgence d’actes terroristes un peu partout sur la planète… nous pouvons détourner le regard, croire que nous ne sommes pas concernés.
Voulons-nous vraiment un nouveau monde ? Sommes-nous assez fous pour vouloir un monde libre, un monde de confiance, un monde sans inégalités, un monde sans violences, un monde écologique, pour soi et pour tous, à transmettre aux générations futures ?
Nous avons toutes et tous un rôle à jouer dans l’histoire, en tant qu’individu. Nous avons même la responsabilité, en tant qu’être humain, de ce monde et le devoir citoyen d’agir. Le vieux monde doit disparaître, ne laissons pas ceux qui ont peur de le perdre défendre ses vestiges pourrissants.
Comment pouvons-nous agir face à l’actualité sportive, politique, à ce qui s’impose à nous, qui nous tombe dessus, dont nous sommes spectateurs tolérants ou impuissants. 0ù est notre actualité, le moment où chacun se sent acteur.
La nécessité de « l’agir » dans l’actualité reste nécessairement fondamentale. Il nous faut retrouver l’agir, retrouver notre capacité d’influer sur l’actualité. Nous ne pouvons pas seulement subir, subir l’actualité des autres. Il nous faut agir, individuellement et collectivement, produire notre actualité, puiser dans nos ressources, puiser dans nos possibles. Ne pas les laisser virtuels. Ne pas souffrir de ce que nous n’avons pas su réaliser, mais agir, réaliser quelque chose, agir non seulement dans l’actualité, mais sur l’actualité.
Comment, me direz-vous, pouvons-nous intervenir dans l’actualité du monde ? Quels possibles devons-nous actualiser pour résister à ce qui semble s’imposer à nous aujourd’hui, le retour de l’actualité du pire, le retour de l’actualité de la guerre ? Comment pouvons-nous agir pour actualiser d’autres possibles ? Il faut puiser dans les virtualités que nous avons, dans les forces que désigne ce mot de « virtualité », ne pas attendre que les possibilités logiques, dans le ciel des possibles, se réalisent toutes seules.
L’actualité dépend de notre décision individuelle d’être acteur, du collectif de notre perception, de notre compréhension, des informations qui nous innondent. Oui, nous pouvons agir pour le meilleur de l’actualité qui ne se fera pas sans nous.
Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde, dans le respect des différences et des croyances de chacun.
Le monde doit se faire avec nous, pour nous !
L’Université Populaire de Marseille-Métropole est impatiente de vous accueillir, pour tenter ensemble de changer le monde.
Jean-Pierre BRUNDU
Président fondateur