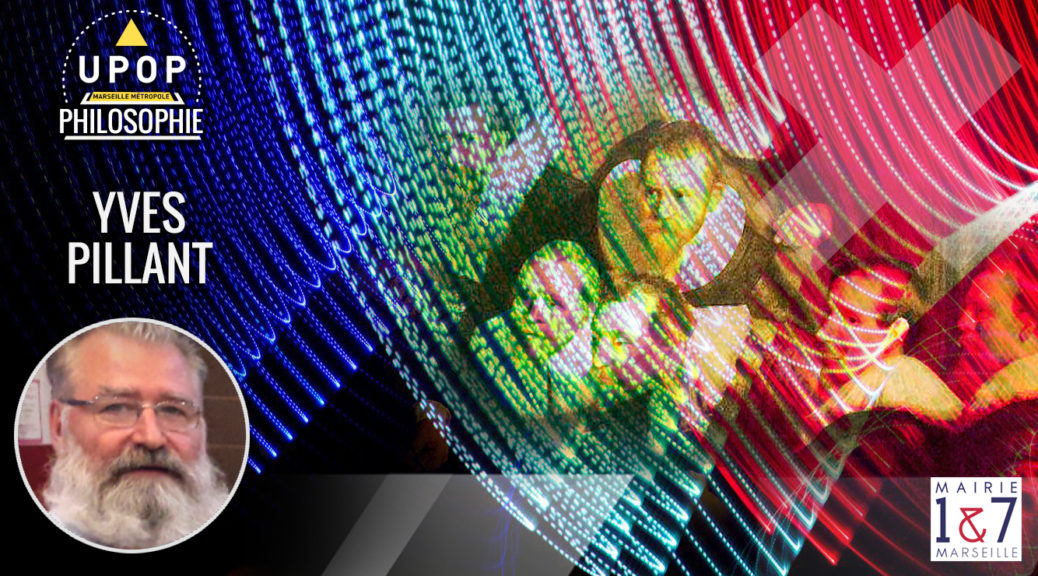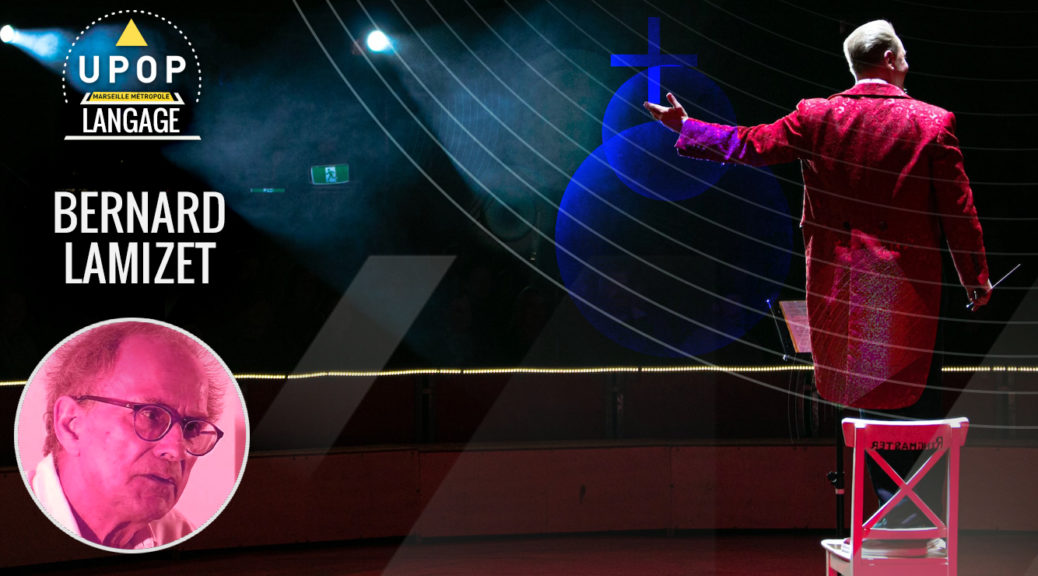Tous les articles par Jean-Pierre Brundu
1/07/24 – Mairie 1&7 – 61 La Canebière
A LA RECHERCHE DU BONHEUR – A L’OMBRE DES UTOPIES FLORISSANTES
Isabelle GRAS– Philosophie
A la recherche du bonheur – A l’ombre des utopies florissantes
« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage » (J. du Bellay, extrait du recueil Les Regrets)
Le bonheur serait-il une conquête ? Dans cette conception humaniste, le bonheur résiderait davantage dans la traversée, l’expérience qui apporte « plein d’usage et de raison », qu’importe le nombre d’escales et les désagréments causés par le périple. Le bonheur serait lié à une affaire de chance dont il faudrait se saisir au moment opportun – à la bonne heure.
Mais quel peut-être aujourd’hui le sens du bonheur dans une société incertaine qui sacralise les plaisirs consuméristes et immédiats ?
Peut-on cultiver le bonheur comme des graines qu’on sèmerait dans l’espoir d’un futur plus prospère ? Faut-il partir à la recherche de porte-bonheurs à collectionner comme autant de trophées témoins d’une bonne fortune ?
Si le bonheur apparaissait comme une idée neuve il y a plus de deux siècles sous la plume de Saint-Just, sommes-nous parvenus à disposer toutes et tous d’un égal droit au bonheur ? Ou bien cette quête collective a-t-elle été supplantée par le règne hégémonique d’un épanouissement individuel ?
Isabelle Gras est diplômée de l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence et titulaire d’un Master 2 en administration publique.
Conservatrice des bibliothèques au Service Commun de la Documentation de l’Université d’Aix-Marseille, elle est responsable des publications numériques en sciences et chargée de mission sur les enjeux d’Open Access et de droit d’auteur.
A ce titre, elle co-anime le groupe de travail national Éthique et Droit pour la diffusion des données en SHS et participe au projet Couperin en faveur de l’accès ouvert aux publications de la recherche
Elle est par ailleurs chargée d’enseignement en culture générale et en sciences de l’information et de la communication à l’IEP d’Aix-en-Provence ainsi qu’à l’Université d’Aix-Marseille où elle intervient également dans le cadre de la préparation aux concours des bibliothèques.
24/06/24 – Société des Architectes – 130 av du Prado
LE LANGAGE DANS LES UTOPIES / DYSTOPIES
Ann COADY – Langage
A quoi ressemble une utopie et quel role y joue le langage ? Dans cette présentation, nous allons explorer plusieurs types de projets utopiques linguistiques : le mythe de la Tour de Babel, les langues philosophiques du XVIIe, les langues auxiliaires internationales comme l’Espéranto, et le langage dans les romans utopiques féministes de la deuxième moitié du XXe siècle.
Mais qui dit utopie, dit aussi dystopie. Ce sont, en effet, deux faces d’une même pièce car l’utopie d’une personne peut très bien être la dystopie d’une autre. Dans son célèbre roman 1984, George Orwell décrit un monde (basé sur les pratiques langagières réelles de l’Union Soviétique à l’époque) dans lequel la libérté d’expression n’existe pas et dans lequel certains mots, comme liberté, sont interdits avec l’objectif d’éliminer le concept lui-même. Le langage devient, contrairement aux projets utopiques, un outil dystopique au service des puissants.
On verra que le langage est un élément de base dans toute utopie et toute dystopie.
Ann Coady est maître de conférences en linguistique à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Elle a terminé son doctorat à Sheffield Hallam University en 2018.
Ses recherches portent sur le genre et la langue, plus spécifiquement la réforme linguistique féministe en anglais et en français, les discours et les idéologies utilisées dans les débats sur le langage sexiste dans les médias.
17/06/24 – Mairie 1&7 – 61 La Canebière
LA POST-CROISSANCE EST-ELLE UNE NOUVELLE UTOPIE ?
Gilles DUFRÉNOT– Économie
"La post-croissance est-elle une nouvelle utopie?
Entre radicalités et complexité"
Les idées de la post-croissance ont le vent en poupe, car d'aucuns la voient comme un levier possible pour une prospérité soutenable et partagée. Est-ce une nouvelle utopie au XXIème siècle, alors que le capitalisme cherche à se métamorphoser pour continuer d'exister? Les positions les plus radicales prônent la décroissance, l'instauration d'un revenu universel, une déglobalisation des économies, tandis que d'autres recherchent une voie médiane vers un régime d'accumulation capitaliste plus respectueux de l'environnement et moins couteux en termes d'inégalités. Quel contenu concret donner à la notion de sobriété, alors que plusieurs centaines de millions de personnes meurent encore de fin sur la planète? Jusqu'où doit aller le partage de la prospérité? Les pays riches peuvent-ils faire une pause dans leur rythme de croissance, en attendant d'être rejoints par les nations émergentes et pauvres? Doivent-ils être plus ouverts au partage des connaissance technologiques? Dans un monde où la conflictualité géopolitique entre nations est de nouveau exacerbée, où les jeunes générations sont en quête de sens, peut-on parvenir à une "sobriété heureuse" sans radicalité? Gilles Dufrénot examine les enjeux de la post-croissance en décryptant la complexité de ses rouages et les métamorphoses profondes qui caractérisent un nouveau régime d'accumulation capitaliste qui se cherche.
Gilles Dufrénot est Professeur des Universités à Sciences Po Aix. Spécialiste de macroéconomie internationale, il travaille sur les unions économiques et monétaires, la stagnation séculaire, les politiques monétaires, budgétaires et de croissance.
Il a publié des articles et ouvrages sur ces sujets. Son livre “Les pauvres vont-ils révolutionner le XXIème siècle, transcender le capitalisme”, publié en 2018 aux Editions Atlande (Paris) a été récompensé par le Prix du Jury Turgot (médaille d’argent) et le Prix de l’AFSE.
Parallèlement à sa carrière académique, Gilles Dufrénot a également exercé comme expert pour des organisations internationales et de grands établissements publics. Il a été conseiller du Commissaire chargé des politiques économiques à la Commission de l’UEMOA.
10/06/24 – Société des Architectes – 130 av du Prado
CHANGER LA VIE PAR NOS FICTIONS
Nancy MURZILLI – Philosophie
Pour un monde de fictions ?
Les fictions sont-elles l’avenir d’un monde en plein bouleversements où la maîtrise des imaginaires est devenue un enjeu de pouvoir ? Et si elles n’étaient pas seulement un travail de l’imagination, mais aussi un moyen de performer le possible, de construire des futurs habitables, de prophétiser nos vies ?
Nancy Murzilli
Professeure à l’Université Paris 8.
Philosophe et théoricienne de la fiction, elle enseigne la littérature française.
Nancy Murzilli s’intéresse à la littérature et à son pouvoir d’action sur le réel, les individus et la société.
Ses recherches portent également sur la rencontre de la littérature avec d’autres formes artistiques.
03/06/24 – Mairie 1&7 – 61 La Canebière
L’ESPRIT CRITIQUE : LA SOLUTION POUR UN MONDE MEILLEUR ?
Denis CAROTI – philosophie
Former l'esprit critique. L'injonction est partout présente : dans les médias ou dans l'éducation, provenant de la sphère politique ou académique, l'esprit critique serait la panacée pour lutter contre (au choix) la désinformation, les complotistes, les croyants, et faire ainsi sortir des ténèbres les plus crédules d'entre nous. Qu'en est-il réellement ? Quels sont les objectifs de cette "éducation à l'esprit critique" qui fait l'actualité et s'impose dans les prescriptions et les thématiques de recherches depuis bientôt 10 ans ? Que sait-on des effets de ces cours et formations qui se développent ? Pour y répondre il faudra d'abord définir ce qu'est l'esprit critique, ce à quoi il aspire et surtout, en quoi il peut répondre aux problèmes de notre société actuelle.
Denis Caroti, Docteur en épistémologie, enseignant, formateur académique et chercheur associé au Centre Gilles Gaston Granger d’Aix-Marseille Université sur la thématique de la pensée critique. Cofondateur du CORTECS (Collectif de recherche transdisciplinaire esprit critique & sciences)· Cofondateur de l'Association Marseille Zététique.Formateur à l'INSPE et chargé de mission au rectorat d'Aix-Marseille. Ses travaux et interventions portent sur l'éducation à l'esprit critique.
27/05/24 – Société des Architectes – 130 av du Prado
COMMENT CONSTRUIRE UNE ÉCOLE QUI FASSE RÊVER ?
Rodrigue COUTOULY, Guillemette LEGENNE et Mehdi CHOUABI – Sociologie
COMMENT CONSTRUIRE UNE ÉCOLE QUI FASSE RÊVER ?
« les défis des enseignants de demain, comment construire une école qui fasse rêver? »
Le métier d’enseignant se révèle de moins en moins attractif. Pourtant, les enseignants heureux existent et ils sont nombreux.
Dans un monde du travail où les métiers sans intérêt pullulent , le professeur peut croire à un métier dont l’utilité n’est plus à démontrer.
Comment changer l’image du métier? Comment le ré-enchanter?
Nous en parlerons avec :
Guillemette Legenne, Mehdi Chouabi et Rodrigue Coutouly.
20/05/24
Jour férié
13/05/24 – Société des Architectes – 130 av du Prado
LA SÉDUCTION : UN « DÉFI » POUR LES ENSEIGNANTS ?
Catherine CAZENAVE – Philosophie
« Il faut séduire les élèves ! ». II est devenu fréquent, de nos jours, d’entendre certains chefs d’établissement faire l’injonction aux professeurs de « séduire » les élèves. On retrouve d’ailleurs cette même injonction dans les centres de formation des nouveaux enseignants. La séduction est soudainement apparue comme ce qui manquait à la « professionnalisation » des enseignants. De nombreux chercheurs « experts » en éducation envisagent ainsi sérieusement de penser la séduction comme une nouvelle stratégie professionnelle devenue incontournable dans la relation pédagogique…
Mais de quoi parle -t-on quand on parle de séduction au sein d’un établissement scolaire? Et en quel sens la séduction, dans notre société néo-libérale, vise -t-elle à introduire de nouvelles formes d’efficacité dans le domaine de l’éducation ?
Catherine Cazenave
Professeure formatrice débats philosophiques, éducation à la citoyenneté, éducation morale, Steam building : recherches sur les processus de création aléatoires.
11/05/24 à 11 h 00 – Bibliothèque de l’Alcazar – 58 cours Belsunce
Du taudis au Airbnb
Victor COLLET – Sociologie
Du taudis au airbnb
Petite histoire des luttes urbaines à Marseille (2018-2023)
https://agone.org/livres/du-taudis-au-airbnb

La conversion du taudis au Airbnb n’est pas l’unique facteur dans la crise du mal-logement qui s’accélère à Marseille. Elle n’est pas la plus déterminante ou la seule raison de l’implantation forcenée de la plateforme non plus. Mais la crise des effondrements et du confinement conjuguées ont offert un terreau particulièrement fertile à une plateforme qui affectionne tant les crises et qui accélère voire démultiplie en retour le mal-logement qui en facilitait l’essor. Boucle vertueuse et spéculatrice pour les uns, boucle maligne et infernale pour les habitants. L’explosion du juteux marché du « meublé » et cette reconversion de l’insalubrité marseillaise lui donnent en tout cas une saveur toute particulière : amère et franchement sordide.
Novembre 2018, Marseille, rue d’Aubagne. Deux immeubles s’effondrent sur leurs habitants : huit morts, une ville traumatisée, une mairie qui fuit toute responsabilité. Triple effondrements : physique, moral, politique. Pourtant, la catastrophe était prévisible, presque annoncée, tant la gestion urbanistique de la deuxième ville de France dysfonctionne depuis trop longtemps.
Connue pour ses marchands de sommeil, qui exploitent sans vergogne le besoin de logement des plus précaires en louant à des prix exorbitants des bâtiments indignes, Marseille est désormais en proie à une frénésie de la rénovation. Détruire puis reconstruire pour rendre la métropole enfin attractive et rentable : l’occasion est trop belle de déplacer les populations pauvres et issues de l’immigration du centre-ville, au gré des mises en péril, plus ou moins légitimes. Gentrification, touristification, soutenue par l’explosion d’Airbnb et l’absence de réglementation de la plateforme. Mais tout cela ne se fait pas sans une certaine résistance populaire. Les luttes pour l’accès à un logement digne préexistent à l’effondrement mais changent de dynamique avec le tourisme et l’installation massive de néo-marseillais, qui participent à l’explosion immobilière.
Né en 1982, Victor Collet a vécu, mené ses recherches et milité dix ans à Nanterre, des luttes de quartier à la défense des étrangers et auprès des habitants des bidonvilles d’aujourd’hui.
06/05/24 – Mairie 1&7 – 61 La Canebière
L’ÉTHIQUE COMME UN PERMANENT DÉFI
Yves PILLANT – Philosophie
L’éthique comme un permanent défi adressé au politique
Certains grands philosophes ont posé, comme une situation naturelle première, des humains qui s’entre-déchirent. Ce point de départ leur a permis de penser l’État et le droit comme nécessaires pour réguler cet état de nature.
Emmanuel Levinas met en cause ce soubassement qui justifie l’édifice d’un contrat social qui symétrise nos rapports et absorbe la dimension unique de chaque une et de chaque un dans une société-masse. Dans cette approche, la visée éthique de nos relations semble difficilement compatible avec une politique surplombante qui parle d’ordre une fois qu’elle a rétréci nos liens à de simples « rapports ».
Nous aborderons donc l’articulation entre éthique et politique, posant l’éthique comme un permanent défi adressé au politique. Nous en viendrons à regarder la possible ou impossible place de la vulnérabilité en politique et les enjeux actuels pour ce qu’on nomme vivre-ensemble.
Yves PILLANT
est à la retraite. Docteur en Philosophie , il est membre associé du Laboratoire interdisciplinaire LIR3S (Recherches Sociétés Sensibilités Soin) du CNRS.
Il a écrit un livre sur « une philosophie de la rencontre. Lecture de notre réalité commune avec Emmanuel Levinas ».
29/04/24 – Société des Architectes – 130 av du Prado
LE DÉFI
Bernard LAMIZET – Langage
Le libéralisme a construit une véritable société du défi. Notre société fonde nos relations sur une logique de confrontation au lieu de la fonder sur une logique de dialogue et d’échange.
Le défi est la forme revêtue dans le langage par la confrontation à l’autre dans la compétition. Défier l’autre, c’est lui proposer une compétition avec soi. C’est ainsi que les opposants défient les pouvoirs de les vaincre, et que les pouvoirs défient leurs opposants de parvenir à les dépasser. Le défi est le nom que l’on peut donner à la revendication du dépassement.
Le défi se manifeste d’abord dans des temps. Il peut s’agir du défi lancé par un membre de la famille aux autres, qu’il s’agisse du défi entre des frères ou des sœurs pour être le préféré des parents, ou du défi entre des héritiers au moment du partage. Plus tard, la figure du défi sera celle par laquelle un acteur social défiera ses opposants de remporter la victoire contre lui.
Mais le défi se manifeste, par ailleurs, dans des espaces. On peut définir ce que J. Habermas appelle l’espace public comme l’espace du défi. C’est le défi qui fait vivre l’espace public en lui donnant sa consistance, en faisant de lui l’espace social de la relation entre les acteurs de la société.
Ancien professeur à l’Institut d’Études Politiques de Lyon, Bernard Lamizet travaille sur les identités et sur la sémiotique politique
22/04/24 – Mairie 1&7 – 61 La Canebière
UTOPIES ET TRAVAIL
José ROSE – Sociologie
Le travail entendu comme une dépense d’énergie en vue de réaliser un produit ou un service, est une activité quotidienne partagée par tous les humains. Elle prend plusieurs formes (salarié, indépendant,
domestique, associatif) et inscrit les personnes dans des rapports de travail, tant hiérarchiques que coopératifs. Le travail est aussi marqué par son ambivalence, tout à la fois source de souffrance et de
créativité, d’exploitation et de possible émancipation. Chacun a un rapport singulier au travail qui, selon les circonstances, prend ou non du sens et assure ou non une reconnaissance.
L’utopie est une critique de l’existant. Elle est une espérance et une nécessité. Elle est une projection vers un ailleurs, un autrement, un meilleur. Elle est un projet destiné à dépasser ce que les situations ont d’insupportable. Elle est une énergie, un désir de dépassement, une
dynamique collective. Elle exprime un rapport spécifique au temps, à l’espace et à l’extérieur. Souvent théorique, elle peut aussi se matérialiser dans des utopies concrètes qui expérimentent de nouvelles manières de faire et de vivre ensemble.
Les utopies du travail sont ainsi de nouvelles façons de concevoir le travail, de l’organiser, de l’orienter, de lui donner du sens. Elles mettent en place des innovations techniques et sociales et testent de nouvelles façons de faire et d’être qui rendent possibles d’autres manières de produire ensemble. Ceci n’exclut pas pour autant, les dimensions ambivalentes du travail ni les difficultés inhérentes à toute forme d’action collective. Dans les utopies, le travail est vertueux, choisi, varié, autonome, source de satisfaction et d’épanouissement.
Ces questions seront développées par Enrico Donaggio et José Rose, membres de l’Atelier de recherche Travail et Libertés (IMERA-AMU).
José Rose est professeur émérite de sociologie à Aix Marseille Université, ancien directeur scientifique du Céreq et membre du LEST-CNRS (Aix Marseille Université). Il travaille notamment sur les transformations du travail et de l’emploi, les relations entre formation et emploi, école et entreprises, l’insertion professionnelle des jeunes et les transitions professionnelles ou encore l’évolution de l’enseignement supérieur.
Enrico Donaggio est Maître de Conférence en Philosophie à l’Université de Turin, professeur de philosophie et pratique de l’interdisciplinarité à Aix-Marseille Université, directeur scientifique de l’Institut d’études avancées (IMéRA), où il coordonne l’Atelier de recherche travail et libertés (ArTLib). Il a coordonné : Travail e(s)t liberté ?, publié par les Éditions Eres, Toulouse.
15/04/24 – Société des Architectes – 130 av du Prado
L’ENTRAIDE EN ÉCONOMIE : ALTRUISME ET RÉSEAU
Renaud BOURLÈS – Économie
Les discussions récentes autour du rôle des aidants dans le cadre du risque dépendance, mais également la gestion des dernières catastrophes naturelles, mettent en évidence l’importance des mécanismes d’entraide dans la gestion des risques. Nous étudierons lors de cette conférence comment ces mécanismes peuvent se substituer ou complémenter l’assurance formelle, et l’importance du lien social pour leur mise en œuvre. Cela nous permettra notamment d’exposer comment l’économie prend en compte les relations interpersonnelles et de mettre en évidence l’importance des réseaux (ou graphes) construit par les liens sociaux.
Renaud BOURLÈS. Professeur des universités en Sciences économiques, spécialisé dans la théorie des contrats et le partage de risque. Responsable de la thématique Économie-Gestion à Centrale Marseille. Membre junior honoraire de l’Institut Universitaire de France.
08/04/24 – Mairie 1&7 – 61 La Canebière
SCÈNES DE PRISON
Leila DELANNOY-AÏSSAOUI – Sociologie
A partir d’une analyse transversale d’expérimentations citoyennes et artistiques en prison, il s’agit de renouveler une réflexion sur les fonctions sociales de la prison.
Leïla Delannoy-Aissaoui est sociologue. Depuis 4 ans, elle mène des recherches-actions au sein de la Direction Interrégionale de l’Administration Pénitentiaire de Marseille. Elle travaille actuellement sur différents sujets, en particulier: la violence carcérale, le métier de surveillant, la création artistique en prison.